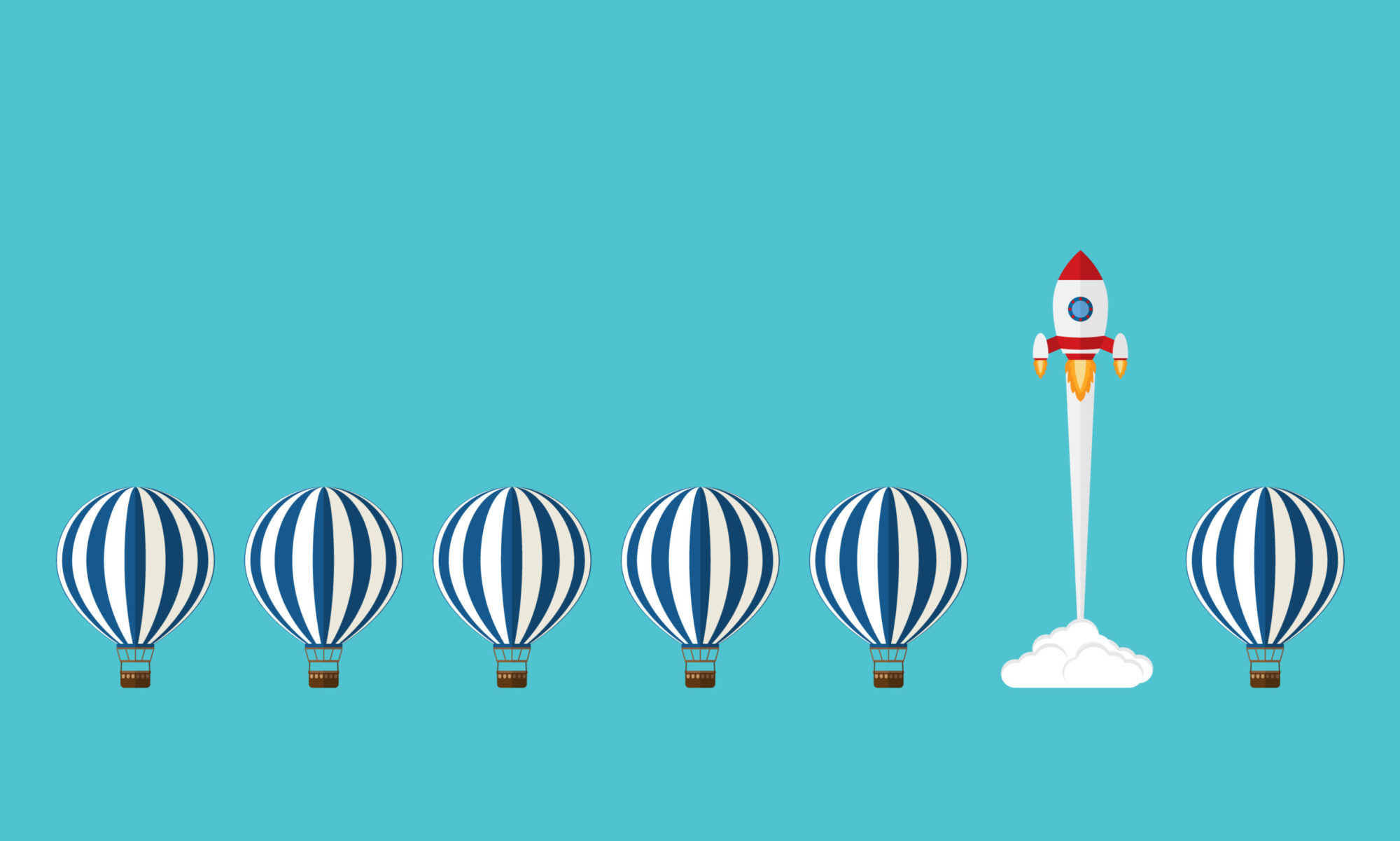Depuis la Loi PACTE de 2019, la Responsabilité Sociétale des Entreprise (« RSE ») est rentrée par la grande porte dans l’architecture du droit des sociétés français
Désormais, et sous certaines conditions d’exigibilité, les sociétés qui le souhaitent peuvent se voir attribuer le « label » de société à mission.
L’objectif principal est d’ajouter à l’intérêt social de la société un intérêt collectif vertueux, social et environnemental.
Après trois ans d’application de la Loi PACTE, l’heure est au bilan !
A ce jour, environ 200 sociétés à mission ont été recensées. C’est peu si l’on considère la communication intense et quotidienne de l’ensemble des sociétés de l’hexagone sur le sujet.
En tant qu’observateur de la toile et des communiqués de presse, on peut avoir l’impression que l’ensemble des sociétés françaises sont entrées sur le chemin courageux de la RSE, et ont inscrit sur leur Kbis le label de société à mission.
Or, entre la communication intense sur le sujet et la réalité juridique, un gouffre s’est creusé. Très peu de sociétés ont finalement franchit le Rubicon et postulé pour le fameux « label ».
Il ne fait aucun doute que la RSE est un important moyen marketing pour les entreprises auprès de leurs clients.
Cependant, les coûts d’une démarche RSE allant jusqu’à l’obtention du « label » de société à mission sont importants, et en réalité, beaucoup s’en tiennent à la publicationde bonnes promesses sur les réseaux sociaux …
C’est ce que l’on appelle le « purpose washing ».
Le phénomène se développe à grande vitesse. Mais relativisons !
Pour s’engager dans une démarche RSE, l’obtention du « label » de société à mission peut être vue est souvent perçue comme la dernière étape d’un long marathon qui comporte de nombreuses phases d’exécution.
Rien n’empêche de communiquer sur ces étapes de réflexions et d’actions dans le cadre de la démarche avant de soulever la récompense tant attendue qu’est la qualification de société à mission.
Alors on peut se poser légitimement cette question : la société à mission est-elle crédible ?
Autrement dit, a-t-on vraiment besoin des sociétés à mission dans le cadre d’une démarche RSE ?
C’est très justement ce que le législateur a voulu étudier en diligentant une mission spécifique sur le sujet qui a abouti au rapport ROCHER.
Après de nombreux entretiens avec des dirigeants d’entreprises de toutes tailles et de secteurs d’activités variés, la sanction est tombée : le label de société à mission n’est pas attractif car trop flou et peu ambitieux dans ses objectifs.
Le rapport fait plusieurs recommandations afin de crédibiliser la société à mission et de permettre aux entreprises d’accéder label.
Les recommandations formulées sont les suivantes :
- Un reporting au moins une fois par an aux actionnaires des sociétés dotées d’une raison d’être statutaire sur l’apport de la stratégie mise en œuvre et des résultats correspondants à cette dernière (Recommandation n°8) ;
- Conditionner une fraction de la rémunération variable (cible minimale de 20 %) des salariés et dirigeants d’entreprises à des critères extra-financiers objectifs en lien avec la raison d’être (Recommandation n°9)
- Obliger les sociétés à mission à publier, à partir de 2027 sur l’exercice 2026, un rapport de durabilité selon les standards de durabilité simplifiés du Groupe consultatif européen sur l’information financière (EFRAG) dans le cadre de la proposition de directive relative à la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises (CSRD), (Recommandation n°10) ;
- Réaffirmer le rôle du conseil d’administration et/ou des instances dirigeantes dans la gouvernance de l’entreprise et préciser le rôle du comité de mission dans la perspective d’une interaction plus collaborative avec les organes de gestion et d’administration (Recommandation n°11)
- Clarifier le champ d’intervention de l’organisme tiers indépendant (OTI) par la publication de l’avis technique et de l’avis motivé type de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes (CNCC) et du guide méthodologique de l’Association française de normalisation (AFNOR). Encourager les entreprises à lancer des appels d’offres pour le choix de leur OTI et travailler à la déconcentration du marché (Recommandation n°12).
Ainsi, les recommandations sont axées sur trois axes majeurs afin de crédibiliser la société à mission :
- La réalisation d’un reporting complet de l’exécution de la mission de la société :
- Vis-à-vis des actionnaires d’abord et une fois par an lors de l’assemblée générale annuelle d’approbation des comptes avec un reporting annexé au rapport du dirigeant. On ne peut que saluer cette recommandation de bon sens.
- Vis-à-vis des tiers enfin grâce à la publication des avis techniques et motivés des OTI et d’un rapport de durabilité EFRAG et CSRD.
- La création d’un comité de mission, qui devient un véritable organe de gouvernance, à l’image d’un comité stratégique ou de surveillance permettant de conseiller les dirigeants sur la mission de la société et son exécution ;
- Une incitation financière des salariés et des dirigeants.
Ces axes permettent de redonner du sens à la société de mission. Mais ils appellent certains commentaires.
D’une part, en pratique, beaucoup de sociétés à mission appliquent déjà certaines de ces recommandations, qui ont vocation à être généralisées. En témoigne la publication du rapport du comité de mission à l’AGOA.
L’incitation financière en fonction de l’obtention de critères RSE fixés par des OTI est, elle aussi, de plus en plus mise œuvre, en particulier dans le domaine de la prise de participation des sociétés via des obligations convertibles. Si la société arrive à l’échéance de ses OC en ayant atteint ses objectifs de décarbonation, le taux d’intérêt de ses obligations baisse. Effet vertueux garanti.
D’autre part, et certains auteurs l’on déjà indiqué, ce rapport ne mentionne pas de nouvelle sanction quant au non-respect des conditions d’exigibilité des sociétés à mission.
Aujourd’hui, une simple suppression de la mention de société à mission sur le Kbis est réalisée, ce qui n’est évidemment pas assez dissuasif. Des sanctions pénales et une amende pourrait être mis en place pour responsabiliser les dirigeants qui décident de se lancer dans l’aventure.
On peut donc s’attendre, aux cours du prochain quinquennat, à l’élaboration d’une loi PACTE 2 qui devrait, on l’espère, inclure l’ensemble de ces recommandations afin de crédibiliser la société à mission !